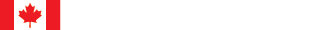Articles
-

La devise québécoise «Je me souviens»
Il fut un temps, au milieu du XXe siècle, où les écoliers québécois terminaient le «salut au drapeau» hebdomadaire par un vibrant «Je me souviens!» À cette époque, le gouvernement du Québec identifiait ses édifices, ses messages et ses publications avec ses armoiries où les citoyens retrouvaient la même devise. La Révolution tranquille a fait disparaître le «salut» et, dans son programme d'identité visuelle, l'État québécois a remplacé les armoiries par la fleur de lis (puis par un fleurdelisé miniature), mais la devise a connu sa revanche en 1978 lorsque le gouvernement Lévesque l'a fait inscrire sur les plaques d'immatriculation québécoises pour remplacer le slogan publicitaire La belle province. Les Québécois ont ainsi leur devise sous les yeux quotidiennement... même s'ils en ignorent souvent l'origine et la signification.
-

De l’interdiction à la préservation du français, paradoxes louisianais du 20e siècle
Les premières années du XXe siècle sont difficiles pour les communautés francophones de la Louisiane. Pour la première fois, à compter de 1915, l’industrialisation rapide et, surtout, l’obligation de fréquenter l’école anglaise menacent leur langue et leur culture. Ainsi, des générations entières perdent graduellement l’usage du français. En 1968, une partie de la communauté réagit, se mobilise et crée le CODOFIL, un organisme qui se donne pour mission de réintégrer le français dans l’enseignement et de valoriser la culture francophone en Louisiane. Bien que parfois critiqué, cet organisme a néanmoins permis de faire de grandes avancées dans la sauvegarde de la langue et de la culture françaises. Le vidéaste Helgi Piccinin a recueilli divers témoignages sur cet aspect fondamental du patrimoine francophone louisianais.
-
Drapeau de Carillon
En 1832, quelques années avant la Révolte de 1837-38, les membres du parti Patriote adoptent un drapeau arborant trois bandes horizontales (verte, blanche et rouge). Après la défaite, la pendaison des Patriotes et la publication du rapport Durham, les Canadiens français se retrouvent à la recherche d'un nouveau drapeau national n'ayant pas le caractère révolutionnaire de ce drapeau tricolore. Quelques années plus tard, lors du défilé du 24 juin 1848 à Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste présente à la foule un drapeau qui aurait été témoin de la victoire de Montcalm sur l'armée britannique à Carillon, en 1758. Ce drapeau frappe l'imaginaire du peuple qui, même s'il ne l'adoptera pas comme tel, lui vouera un culte au point d'influencer l'allure définitive du drapeau québécois.
-

Drapeau du Québec : le fleurdelisé
Des lendemains des Troubles de 1837-1838 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens français arborent le plus souvent le drapeau de la France, le tricolore bleu-blanc-rouge, qui, à leurs yeux, représente le mieux leur caractère distinct. Mais, au tournant des XIXe et XXe siècles, émerge chez les francophones le désir de se doter de leur propre drapeau, plus en accord avec leur identité nord-américaine. Plusieurs projets soumis dans les années 1901 à 1905 participent à la genèse du drapeau actuel, tout particulièrement le fleurdelisé du curé Elphège Filiatrault et le Carillon-Sacré-Cœur. Après bien des péripéties, le fleurdelisé, tel que nous le connaissons aujourd’hui, devient, le 21 janvier 1948, drapeau officiel du Québec. Depuis, il constitue un symbole fort de l’identité des Québécois, flottant sur les bâtiments officiels du Québec, ainsi que devant bien des résidences privées, ou encore fièrement hissé par la population en diverses circonstances, particulièrement lors des moments forts de son histoire.
-

Langue française, patrimoine fondamental des Québécois et des Français
L’identité (qui doit être distinguée de la nationalité comme de la citoyenneté) lorsqu’elle est collective, renvoie au sentiment de spécificité qu’éprouve tout un groupe ; elle est à la fois conscience de soi et image que l’autre (ou les autres) envoie de vous. Parfois l’identité est liée à la religion (lorsqu’elle permet de résister ou de s’opposer à un voisin dominant) ; par exemple : l’orthodoxie des Grecs, le catholicisme des Irlandais et des Polonais. Aujourd’hui l’Islam sous sa version radicale et politique est revendiquée comme une marque identitaire d’affirmation (ou à l’inverse comme objet de stigmatisation). La communauté de langue a aussi été dans le passé comme encore aujourd’hui une caractéristique identitaire, parce que l’identité comme le disait Lautréamont est liée à la permanence qui défie les aléas de l’histoire. Ainsi se trouvent associées trois dimensions : mémoire, langue et identité. Contrairement à la théorie allemande du XIXe siècle qui mettait en avant la langue comme fondement exclusif de la nationalité, la tradition française (et aussi francophone) associe la fidélité à la langue à la volonté collective de la défendre et de l’illustrer, et aussi aux luttes collectives qui permettent aux peuples de s’émanciper et de s’affirmer. Rappelons enfin que la langue n’est pas un simple code de communication mais une mémoire ainsi qu’une âme collective grâce aux milliers d’images, de métaphores, de tournures de phrases, de finesses syntaxiques qui la caractérisent, sans oublier les milliers de mots parfois intraduisibles littéralement, tant ils sont enracinés dans un terreau original fertilisé par une histoire que l’on souhaite continuer à écrire en commun.
-

Parlement de Québec : lieu de mémoire
Réalisé entre 1875 et 1886, l’hôtel du Parlement de Québec compte aujourd’hui parmi les édifices les plus représentatifs du patrimoine architectural québécois. Tant par sa facture que par son style, il évoque le passé, le présent et l’avenir d’une nation éprise de démocratie. Son imposante carrure en pierres de taille, sa silhouette distinctive, sa décoration intérieure sont autant d’éléments qui rappellent, selon les intentions de son architecte, Eugène-Étienne Taché, les origines françaises de ce coin de pays en terre d’Amérique. Orientée vers le levant, la façade du bâtiment, édifié tout près des fortifications du Vieux-Québec, s’orne de nombreuses sculptures qui racontent les différentes épopées liées à la fondation du Canada et du Québec. Sur le fronton de l’entrée principale se trouve gravée la devise du Québec : « Je me souviens ». Évocation du chemin parcouru depuis 1534, cette devise actualise l’histoire politique et rappelle à celui qui la lit qu’en ce parlement siègent toujours l’assemblée du peuple et le gouvernement élu.
-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les développements
Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Au XIXe siècle, l'expansion du cartésianisme et des ambitions de la science favorisée par les voyages transatlantiques ainsi que par des communications plus régulières et plus intenses entre l'Amérique et l'Europe, se manifeste par des débats sur le statut de la connaissance et une réflexion politique et sociale de plus en plus développée. Deux grandes périodes se succèdent. On assiste d'abord au développement de courants de pensée progressistes, inspirés de la philosophie de Descartes. Puis survient un retour prudent aux idées traditionnelles davantage compatibles avec la doctrine catholique. Au final, les échanges constants entre les intellectuels et penseurs de la France et du Canada français sont à la base de la culture contemporaine des communautés francophones du Québec et du Canada.
-

Royal 22e Régiment
Le Royal 22e Régiment (R22R) est l’un des trois régiments d’infanterie de la Force Régulière du Canada dont le quartier-général se trouve à la Citadelle de Québec. C’est un régiment francophone qui se compose de cinq bataillons dont trois appartiennent à la Force Régulière et deux à la Force de Réserve. Le régiment a participé à tous les engagements majeurs livrés par le Canada depuis la Première Guerre mondiale, en passant par les missions de paix des Nations-Unies et la campagne d’Afghanistan. Sa riche histoire et son patrimoine, tant matériel qu’immatériel sont aujourd’hui mis en valeur de différentes manières au cœur de la ville de Québec.
Images
-
La bataille du long s
aultArticle :
Dollard des Ormeaux -
Drapeau « Je me souvi
ens »Article :
Drapeau de Carillon Drapeau du Québec : le fleurdelisé -

Armoiries de la provi
nce de QuébecArticle :
Drapeau du Québec : le fleurdelisé La devise québécoise «Je me souviens» -
Le Courreur des bois
Article :
Trappeurs francophones des Plaines et des Rocheuses étatsuniennes
-

«Je me souviens», scu
lpture par J.B....Article :
La devise québécoise «Je me souviens» -

A Licence to Remember
: Je me souvien...Article :
La devise québécoise «Je me souviens» -

Plaque d'immatriculat
ion du Québec, ...Article :
La devise québécoise «Je me souviens» -

Vue rapprochée d'une
plaque d'immatr...Article :
La devise québécoise «Je me souviens»